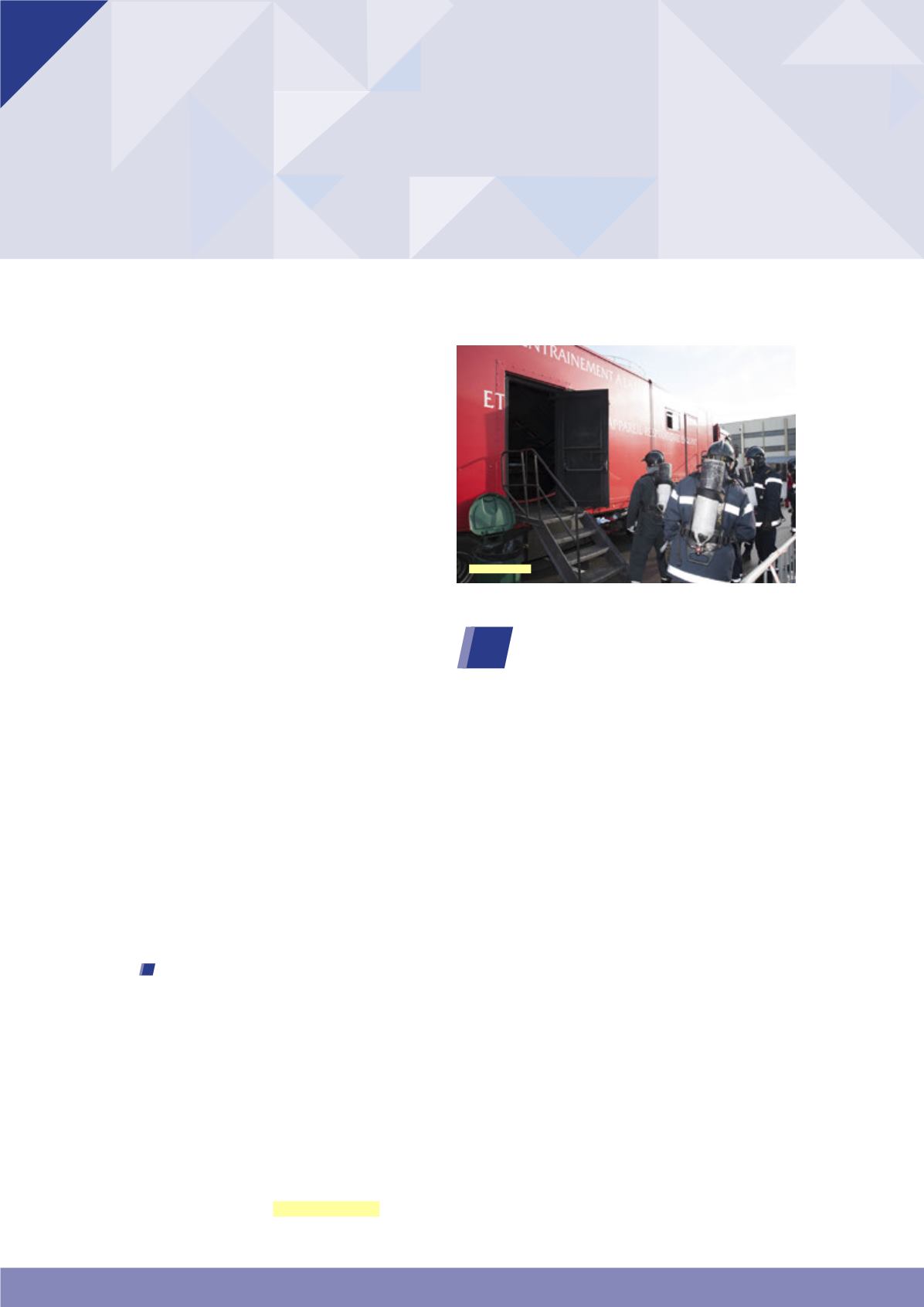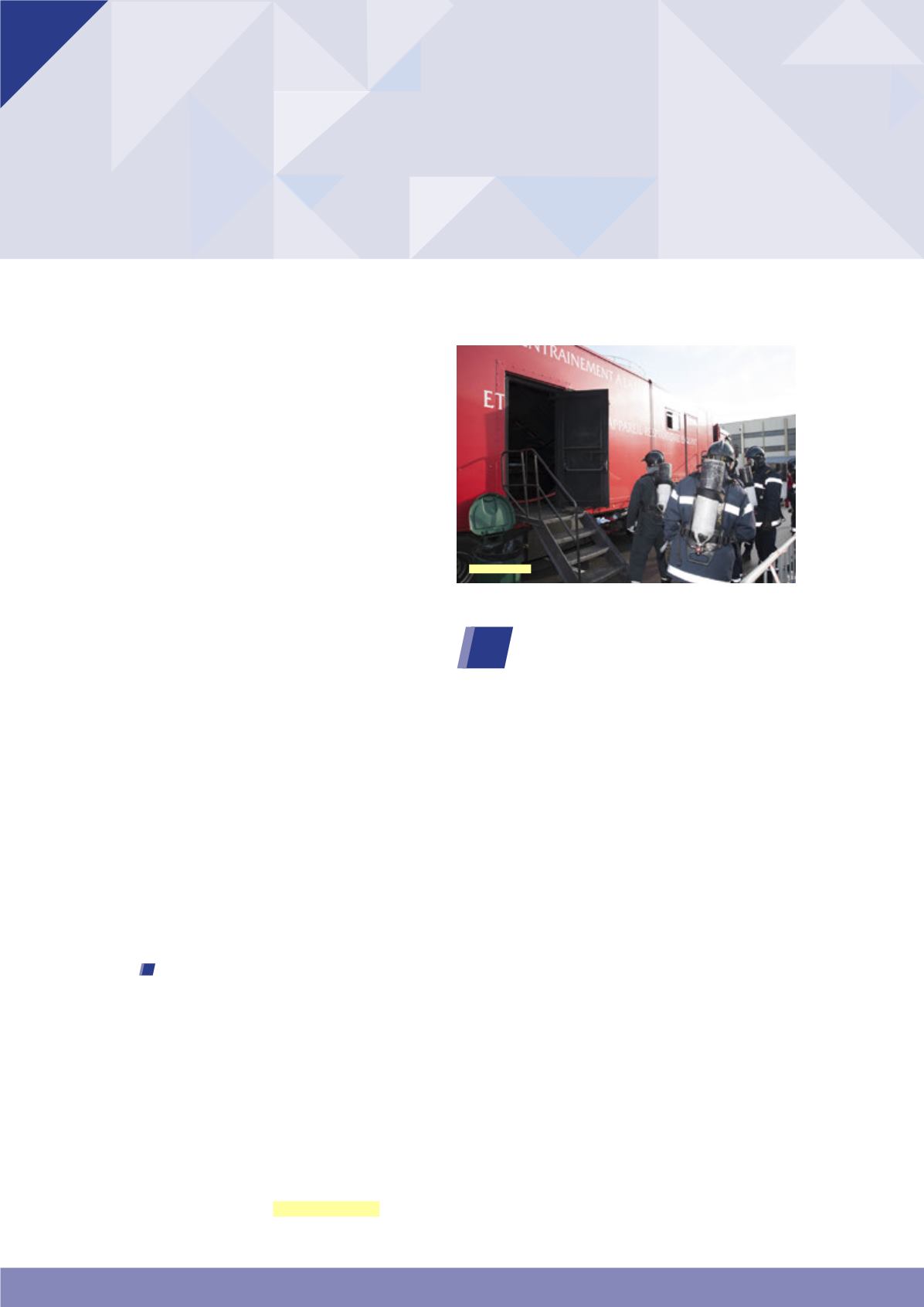
42
La circulaire n°DGOS/RH4/2013/295 vient faciliter la
construction des plans de formation et des plans de
DPC en proposant pour 2014, sept axes avec plusieurs
thématiques prioritaires. Ces axes sont déclinés en dix-
sept actions de formation et de développement profes-
sionnel continu, deux actions de formation nationales
(AFN) et deux programmes nationaux de développe-
ment professionnel continu.
Il appartient ainsi au CHU de définir ses priorités d’ac-
tions en matière de développement des compétences
en fonction de ses enjeux, de ses projets et du recen-
sement des besoins des agents. Ces priorités doivent
soutenir les dynamiques d’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins dispensés aux patients.
En ce qui concerne le DPC médical dans la mesure où
les axes prioritaires sont définis au niveau national et
que chaque médecin peut suivre la formation qu’il sou-
haite en se référant aux collèges ou sociétés savantes
souvent organismes agrées DPC (l’exemple est donné
du SNFAR) sans pour autant avoir à s’inscrire dans le
dispositif porté par le CHU
Les programmes DPC ont été validés en commission
du 19 juin 2013 et en commission du 24 septembre
2013, programmes communs au personnel médical
et au personnel non médical. Les programmes DPC
s’inscrivent dans leur grande majorité dans les axes
prioritaires 2014 issus de la circulaire du 19 juillet 2013
ce qui permet de construire un projet DPC cohérent au
niveau du CHU. Parmi ces programmes, l’on peut citer
« gestion de l’intubation et de la ventilation difficile »,
« les situations hémodynamiques critiques au bloc
opératoire » ; « Escarres : prévention et traitement » ;
« Douleur et analgésie en soins palliatifs », « les incer-
titudes de mesure appliquées à la métrologie en labo-
ratoire de biologie médicale ».
La parution du guide de la formation du CHU de Li-
moges, sous l’égide de la Direction des Ressources
Humaines vient préciser et expliciter le catalogue de
l’ensemble des formations disponibles.
Quelques chiffres
■
Formation du personnel médical en 2013
:
Au second trimestre 2013, 45 praticiens ont suivi des
programmes comme « Manager et coordonner la ges-
tion des risques associés aux soins en établissement
de santé », ou « La prise en charge de l’allergie et de
l’arrêt cardio-respiratoire ».
■
Formation du personnel non médical en 2013
:
402 agents ont bénéficié d’une formation dans le cadre
du DIF en 2013. Cela représente quelques 6325 heures
de formation réalisées sur le temps de travail.
Parmi les formations les plus suivies en 2013, on dé-
nombre la formation sur la sécurité incendie (699 bé-
néficiaires) ; la réforme des études paramédicales (158
bénéficiaires), la mise en œuvre des nouveaux en-
tretiens d’évaluation (137 bénéficiaires), ou encore la
gymnastique du personnel (122 bénéficiaires).
FOCUS SUR
LE SERVICE SOCIAL
HOSPITALIER
En 2013, le service social hospitalier a une fois encore
mis son expertise au service des patients, mais éga-
lement du personnel du CHU. Le service social hospi-
talier participe ainsi à la fois à la qualité de la prise en
charge du patient dans sa globalité, il est également
partie prenante de la mise en œuvre du projet social
du CHU.
Les assistants sociaux hospitaliers ont en effet pour
principales missions de garantir un accès aux soins,
assurer l’accès aux prestations sociales, ou encore
appliquer les mesures de protection des majeurs, des
personnes vulnérables et des mineurs. Ils ont égale-
ment un rôle stratégique majeur pour l’établissement,
en participant à la bonne orientation des patients à la
sortie de l’établissement, en cherchant des solutions
d’aval : orientation de patients vers d’autres structures
sanitaires, médico sociales ou sociales et développe-
ment de partenariats. Ils organisent les retours à domi-
cile. Plus largement, ils ont pour mission de conseiller,
orienter, accompagner les patients et leurs proches
dans divers domaines.
Ils ont également des missions spécifiques :
•
Accueillir,
écouter, informer, conseiller, orienter
vers les services plus compétents internes ou ex-
ternes à l’établissement, pour favoriser le maintien
et l’accès aux droits.
•
Evaluer
la globalité d’une situation,
•
Proposer des solutions adaptées enfonction
4